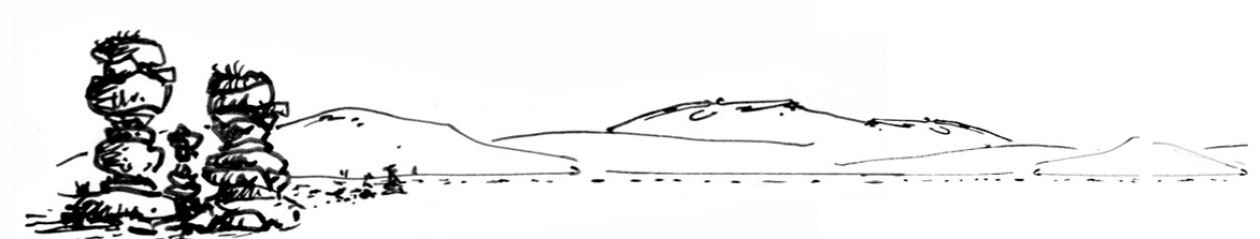La techno creuse des brèches droites et régulières dans la lourde chaleur de la mi-journée. Sous un dais rouge, des vacanciers stoïques sont vautrés comme chaque midi dans les fauteuils de jardin rembourrés du bar, les regards consomment visages et corps étrangers comme des spots publicitaires bon marché qu’on laisse glisser devant ses yeux avec curiosité et ennui au milieu d’un film. Sur la route côtière, de lourdes remorques surbaissées peintes d’un beau blanc éblouissant transportent leurs véhicules blindés blancs à travers les corps bronzés que la mer a déposés là ; des maillots et costumes de bain dégoulinants, une bière fraîche juste sous les yeux, ne les remarquent même pas et scrutent l’autre côté de la route à la recherche d’éventuels fauteuils libres sous l’énorme enceinte noire. Un convoi militaire muet peint en blanc traverse sans bruit les pulsations de la techno. Ils ne laissent plus passer les unités de l’ONU vers l’intérieur du pays, indique l’article en troisième page qu’Ònytjungur a devant lui. Ce soir encore, ils resteront à attendre dans leurs remorques surbaissées.
Ònytjungur a l’impression qu’on lui a fendu la tête en deux avec une hache, il fixait les gens, sa bière, les gens, sa main, la bière, les visages, les corps, et sentait ses pensées s’efforcer de recoudre et de rassembler les deux moitiés disjointes.
Là-haut, c’est la vallée avec son silence de mort, avec les restes de murs noircis par la fumée, les poutres carbonisées et mutilées, on peut encore sentir les habitants, la sueur de leur travail, les épices de leur déjeuner, mais ils n’étaient plus là. Maison après maison, un paysages de ruines muet, comme si une coulée de lave mortelle avait descendu la vallée et emporté, arraché, consumé, enfoncé tout ce qui se dressait sur son passage. Mais les prairies vertes et jaunes, les buissons touffus, la négligence luxuriante étaient toujours là, les ruines calcinées aussi fraîches que si une seule nuit s’était écoulée et avait tout changé. Silence de mort. Odeur d’incendie. Fermes sans toit, les unes après les autres, et au prochain virage la prochaine ruine. Une vallée qui a apporté la mort. Et toujours ce sursaut en apercevant à travers les arbres un coin de maison intact, de plus près, en fait celle-là aussi est calcinée, sans toit, certains murs criblés d’éclats de balles, d’autres sans traces de combat, simplement incendiés, une maison après l’autre, et encore une après l’autre, au milieu de ça un paysan devant ses fenêtres à rideaux, devant sa cour intacte, cultive avec amour les légumes de son jardin. Un Croate.
 Où est ton voisin, Croate, voudrait lui crier Ònytjungur, et il voudrait y aller, mais il n’y va pas, il ne lui demande pas. C’est que cette maison est intacte, tout à fait paisible même au milieu de toutes les ruines, qu’elle était déjà là au moment où on a brûlé des fermes, abattu des familles, et bombé « HOS » sur les restes de mur calcinés, comme on appose fièrement son titre au bas d’une condamnation à mort. C’était un témoin de l’époque, comme le disent les historiens. Ce paysan qui cultive ses légumes dans son jardin. C’était son voisin. Et peut-être s’est-il terré dans sa maison, en se disant sans doute, ça ne nous regarde pas, mais il est bien plus probable qu’il se tenait lui aussi devant la maison du voisin lorsqu’elle a brûlé, peut-être avait-il lui aussi une torche à la main. Cette même main qui extrait avec soin les mauvaises herbes de la terre du jardin. Car les légumes sont croates. Le voisin, lui, était un Tchetnik. On dit Tchetnik, pas Serbe, pour parler des Serbes, on prend un nom du passé, celui que se donnèrent un groupe de bouchers serbes pour pouvoir abattre des êtres humains. Le voisin est donc Tchetnik, pas Serbe. Ça facilite beaucoup de choses.
Où est ton voisin, Croate, voudrait lui crier Ònytjungur, et il voudrait y aller, mais il n’y va pas, il ne lui demande pas. C’est que cette maison est intacte, tout à fait paisible même au milieu de toutes les ruines, qu’elle était déjà là au moment où on a brûlé des fermes, abattu des familles, et bombé « HOS » sur les restes de mur calcinés, comme on appose fièrement son titre au bas d’une condamnation à mort. C’était un témoin de l’époque, comme le disent les historiens. Ce paysan qui cultive ses légumes dans son jardin. C’était son voisin. Et peut-être s’est-il terré dans sa maison, en se disant sans doute, ça ne nous regarde pas, mais il est bien plus probable qu’il se tenait lui aussi devant la maison du voisin lorsqu’elle a brûlé, peut-être avait-il lui aussi une torche à la main. Cette même main qui extrait avec soin les mauvaises herbes de la terre du jardin. Car les légumes sont croates. Le voisin, lui, était un Tchetnik. On dit Tchetnik, pas Serbe, pour parler des Serbes, on prend un nom du passé, celui que se donnèrent un groupe de bouchers serbes pour pouvoir abattre des êtres humains. Le voisin est donc Tchetnik, pas Serbe. Ça facilite beaucoup de choses.
Le pompiste se fend d’un large sourire lorsqu’Ònytjungur s’enquiert de la route de Plitvice. Les panneaux qui indiquaient jadis la route de Plitvice avaient disparu, comme si Plitvice n’existait plus. Le pompiste de Josipdol sourit d’un air entendu, et ouvrit sa main comme s’il tenait un pistolet avant de replier plusieurs fois l’index. « Tchetniki », dit-il en souriant, comme si leur présence datait d’aujourd’hui.
Des faisceaux de câbles longent la route de Josipdol. Des lignes de communication pour l’armée croate, qui traîne dans les cafés et les bars, rieuse et détendue, ils ont l’œil des vainqueurs ; ils rient, détendus, dans leurs postes de combat dissimulés le long de la route derrière les cours de ferme et les bars. Un panneau géant sur le bord de la route ordonne aux étrangers de ne pas séjourner hors des localités, de ne pas s’arrêter, de ne descendre de voiture que dans les localités fermées. Mais il n’y a plus d’étrangers. Ils se pressent dans le vide touristique, sur la route côtière, vers les pontons et les places de port désormais libres.
Il y était aussi, c’est sûr, a pensé Ònytjungur, en regardant le paysan planter pensivement une rangée de plantes vivaces le long de son carré de légumes. Il y était aussi, c’est sûr, et il ne s’est pas caché derrière ses rideaux, car ils font tous partie d’une conjuration, ils se font des clins d’œil, ils s’interpellent les uns les autres. Ils échangent des sourires et discutent dans les rues de la ville proche d’Otocac, une commune de vainqueurs, on s’en est débarrassé, de ces Tchetniks, et là où ils étaient, le pimpant lotissement de résidences familiales s’orne d’une ruine noircie, un déblai au milieu des jardins en fleur. Ils se connaissent, ils se parlent. Loin de la stérilité et de l’isolement de l’Europe allemande, ils s’affairent et vaquent fièrement à leurs conquêtes, ici les horloges tournent bien moins vite, et on se parle par-dessus la rue d’un balcon à l’autre, on se connaît, on se connaît même de nom, les visages ont encore des noms, plus encore dès qu’on est dehors, dans les cours de ferme, dans la vallée. Et au-delà de toutes ces connaissances, on peut sentir, on peut voir ce qui va plus loin, le lien qui les lie tous : c’est un Croate, un Catholique, il fait partie de la famille. Maintenant plus que jamais, car c’est ensemble qu’on a nettoyé les Serbes, plus aucun Orthodoxe comme voisin. Les drapeaux croates ornent maison après maison, partout des militaires, des uniformes, des contrôles routiers. Entre les véhicules militaires et les vestes de camouflage vertes, des véhicules privés sans plaque d’immatriculation, deux, trois hommes en maillot de corps noir en route vers l’ennemi, véhicules sans nom, hommes sans nom. Mais pour la première fois, on est entre soi, soldat, civil et maillot de corps noir. On est entre soi, une circonstance qui n’a jamais eu de poids au cours des dernières décennies, car on faisait des affaires ensemble. Serbe, Croate, Catholique ou Orthodoxe, on se retrouvait pour un café et un brin de conversation. Désormais, les boutiques serbes sont vides, condamnées, il n’y a plus de Serbes, pas ici, plus ici. Désormais, il y a des voitures sans immatriculation et des maillots de corps noirs.
 Ònytjungur observe le profil de la soldate croate au milieu des vacanciers. Le visage dans l’ombre caché par des lunettes de soleil noires mates, la coupe de cheveux nette, la veste de camouflage grossière, le pantalon de treillis, la large ceinture sur la taille mince, la canette de bière, ce fin crucifix d’argent suspendu au lobe de l’oreille comme un corps balançant à une branche. Les vacanciers jettent des regards à travers l’ambiance détendue, elle non, elle fixe un poteau de béton. Un monument immobile, jusqu’à ce que le chef siffle et rassemble sa troupe. En une demi-heure, elle n’a vu personne dans cette illustre assemblée, rien d’autre que ce poteau de béton sous les enceintes. Cette soldat est une combattante, pense Ònytjungur, elle n’a pas besoin de voir autre chose que cette surface de béton, et son visage est détendu. Elle n’a même pas besoin de ses camarades, de l’autre côté, qui épient les bikinis par-dessus leurs canettes de bière en ricanant jusqu’au sifflement. Debout, on ramasse ses affaires, on continue. Des personnages dans un dessein. Au bout, une autre nation, nettoyée, purifiée. Un membre nettoyé de la communauté des nations, un partenaire nettoyé pour les affaires. Demain, on déblaiera les maisons calcinées et avec elles les dernières traces révélatrices. Cela n’aura jamais été, cela n’est déjà plus depuis longtemps. Le journal annonce déjà sur une pleine page que les plages sont propres, plus propres qu’elles ne l’ont été depuis longtemps, car elles sont restées quelque temps inutilisées. Des nouvelles importantes de Croatie. Ònytjungur parcourt la ville criblée de balles. L’homme meurt d’abord, puis la vérité, le reste appartient à l’Histoire.
Ònytjungur observe le profil de la soldate croate au milieu des vacanciers. Le visage dans l’ombre caché par des lunettes de soleil noires mates, la coupe de cheveux nette, la veste de camouflage grossière, le pantalon de treillis, la large ceinture sur la taille mince, la canette de bière, ce fin crucifix d’argent suspendu au lobe de l’oreille comme un corps balançant à une branche. Les vacanciers jettent des regards à travers l’ambiance détendue, elle non, elle fixe un poteau de béton. Un monument immobile, jusqu’à ce que le chef siffle et rassemble sa troupe. En une demi-heure, elle n’a vu personne dans cette illustre assemblée, rien d’autre que ce poteau de béton sous les enceintes. Cette soldat est une combattante, pense Ònytjungur, elle n’a pas besoin de voir autre chose que cette surface de béton, et son visage est détendu. Elle n’a même pas besoin de ses camarades, de l’autre côté, qui épient les bikinis par-dessus leurs canettes de bière en ricanant jusqu’au sifflement. Debout, on ramasse ses affaires, on continue. Des personnages dans un dessein. Au bout, une autre nation, nettoyée, purifiée. Un membre nettoyé de la communauté des nations, un partenaire nettoyé pour les affaires. Demain, on déblaiera les maisons calcinées et avec elles les dernières traces révélatrices. Cela n’aura jamais été, cela n’est déjà plus depuis longtemps. Le journal annonce déjà sur une pleine page que les plages sont propres, plus propres qu’elles ne l’ont été depuis longtemps, car elles sont restées quelque temps inutilisées. Des nouvelles importantes de Croatie. Ònytjungur parcourt la ville criblée de balles. L’homme meurt d’abord, puis la vérité, le reste appartient à l’Histoire.
Un immeuble d’habitation, un étage sur l’autre, un balcon après l’autre, le dernier balcon, au cinquième étage, est détruit, un voile noir couvre les murs au-dessus des chambranles carbonisés, l’appartement est criblé d’impacts derrière le balcon du cinquième étage, la guerre sur dix mètres carrés de cloison, le reste est intact. Là, des hommes ont été chassés par les armes, par la fumée, abattus dans l’incendie, les appartements du dessous ont pu rester des appartements, celui du haut était en territoire ennemi, maintenant il est à nouveau habité, du linge sèche sur la rambarde du balcon, du linge croate désormais. Le précédent locataire s’est-il barricadé, a-t-il peut-être même répliqué aux tirs, de sorte que cette unité d’habitation, parmi vingt autres sous le même toit, a été isolée, séparée et soumise à une concentration de feu ? Qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de cet homme, ou était-ce une femme, une famille, qu’est-ce qui leur est passé par la tête pour qu’ils fassent de leur salon une forteresse, à quelle distance pouvaient-ils voir, jusqu’au prochain tir, jusqu’à la prochaine minute, un petit appartement au cinquième étage d’un immeuble d’habitation, entouré d’ennemis qui hier encore étaient des voisins et qui désormais portaient des armes. Pourquoi lui ou sa famille ne sont-ils pas descendus ? Qu’est-ce qui a pu le pousser, la pousser, à faire de leur petit appartement confortable avec les photos de famille sur les commodes une position militaire, un poste de combat, des ennemis en haut, en bas, à côté, dehors et dedans, les rafales éclatent sur le mur du salon, la pièce prend feu sous les impacts. Les chefs de guerre de tous les pays ont fait de leurs villes des forteresses, partout et toujours, mais un salon au cinquième étage ? Ou bien ne voulait-on pas du tout qu’il descende, aurait-il rencontré devant sa maison la même fin que dans son salon pris sous la mitraille ?
Non loin, des hommes se saluent d’une tape sur l’épaule, commandent du café, une bière, s’assoient, parlent, le temps passe lourd et pensif, la journée s’achemine paisible et familière vers la fraîcheur du soir, un type enfonce un drapeau croate haut comme un homme à travers le toit ouvrant de sa petite voiture et s’en va quelque part, là où ce drapeau doit aller. Des vieillards sont assis sur les bancs du parc devant les façades détruites de la place du marché. Cette ville est nettoyée de ses Serbes, et des obstacles anti-chars aux portes de la ville marquent la fin de la route de Plitvice. Derrière le barrage anti-chars, on trouve les prochaines ruines au milieu des fermes intactes, la suite de la vallée est nettoyée de ses Croates. La vallée dans son ensemble présente un aspect identique, c’est une image, une réalité, deux parties séparées par des obstacles anti-chars ne pourraient pas se ressembler davantage. Seule la tête, le lieu de naissance des idées, sait qu’il y a de ce côté des Croates et pas de Serbes, de l’autre côté des Orthodoxes et pas de Catholiques, chaque côté désormais nettoyé de ses Serbes, de ses Croates, et lorgnant sur l’autre côté. Un homme à béret bleu se tient près de sa jeep blanche comme un poteau frontière, il marque la ligne de cessez-le feu, un clou planté dans la viande des têtes. Devant lui, dans la ville, l’armée croate se regroupe, les véhicules passent l’un après l’autre le poste devant le quartier général, la police militaire contrôle les ordres de marche à un point de contrôle, l’armée croate prend ses positions devant Plitvice.
L’homme rit depuis la capote ouverte de sa BMW munichoise. Ce n’est qu’un cessez-le-feu, rit-il, ça peut repartir à tout moment, ma maison est juste devant le barrage anti-chars, me voilà de retour à la maison. Il a une jolie maisonnette, le jardin est bien soigné, la parcelle voisine est une ruine noircie, une ex-maisonnette, un ex-voisin, une ruine solitaire au milieu des jardins en fleur bien soignés. Où est ton voisin, Croate, voudrait lui crier Ònytjungur. Mais l’homme rit dans sa décapotable ouverte, et sa BMW est astiquée avec une minutie toute allemande.
Ònytjungur doit beugler pour franchir le bruit de la techno et s’adresser au visage interrogateur de la serveuse stylée : « Vous avez des cevapcici ? » La jeune fille secoue la tête avec ennui. Puis elle sourit comme une mère dont l’enfant a encore posé une question absurde, et lui confie d’un air amusé : « plat serbe ! »
Sous un dais rouge, des vacanciers stoïques sont vautrés comme chaque midi dans les fauteuils de jardin rembourrés du bar, les regards consomment visages et corps étrangers comme des spots publicitaires bon marché qu’on laisse glisser devant ses yeux avec curiosité et ennui au milieu d’un film. Le beat de la techno réduit les cerveaux à cette indifférence sur laquelle fleurissent les nations. Jusqu’à ce que la première balle éclate à côté de toi. Mais alors il est trop tard. Le CD, lui, survivra, quelque part, dans une archive, pour les générations futures, comme témoin numérique d’une époque. Car la vérité change dès la première bière.
22. August 1994
(un souvenir à l’occasion du 20ème anniversaire de l’opération « Oluja»)
Traduction: Cyrille Flamant
 Der Rest ist Geschichte
Der Rest ist Geschichte
 History will take care of the rest
History will take care of the rest